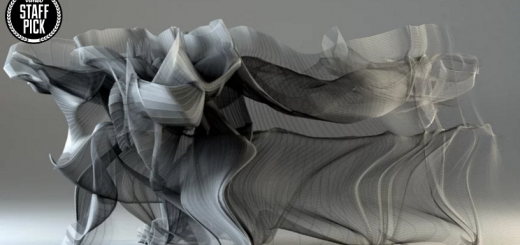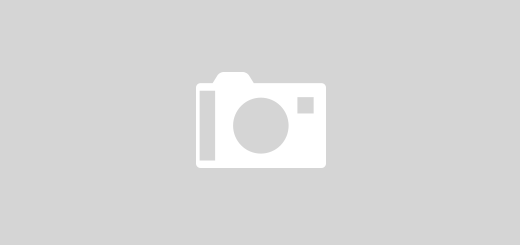Le complexe phallique
La psychanalyse ressemble parfois au final du film Usual Suspects (1) : tous les indices sont sous votre nez depuis le début, mais, victime de votre appétence pour les belles histoires rocambolesques, vous mettez des lustres à en élucider la trame cohésive. Cette thèse s’applique autant à l’écoute des patients qu’à l’assimilation des concepts de la discipline, j’en veux pour exemple le casse-tête autrichien qui m’occupe depuis une dizaine d’années : l’angoisse de castration.
L’expression recouvre une réalité complexe. Si l’on interprète littéralement la pensée freudienne, la fantasmatique infantile raconterait ceci: les filles avaient un pénis mais quelqu’un le leur a pris, leur souhait le plus cher est donc d’en retrouver un. La situation est frustrante pour elles et inquiétante pour les garçons, car eux aussi pourraient perdre leur attribut sexuel, soit parce que leur père veut rester le mâle dominant, soit parce que la mère – ou une autre fille – veut combler son manque.
Je pourrais sombrer à ce stade de la réflexion dans l’hystérie- que le contexte culturel d’émergence de la psychanalyse a si généreusement imputée à toute revendication d’émancipation féminine- en m’ insurgeant contre ce mythe délirant. Mais au-delà de l’injustice ou du ridicule, il me semble plus pertinent d’interroger l’implicite : qu’est-ce qui peut bien effrayer l’homme au point d’imaginer que l’autre moitié de l’humanité lui envie son entrejambe ? De quoi est porteuse pour lui cette différence corporelle ?

A ceux qui privilégient le fond sur la forme, la psychanalyse révèle ceci : le pénis est un objet phallique, c’est à dire une incarnation de la puissance, voire un fétiche lorsqu’on le croit réellement investi du pouvoir absolu. Le posséder et en jouir c’est se vivre comme le roi du monde ; le découvrir désinvesti de sa “magie” – sa faculté de provoquer la jouissance ou la vie en l’autre – c’est prendre en pleine face sa vulnérabilité. En d’autres termes, c’est faire l’expérience de ce que l’on croit être la déchéance de la femme dévirilisée. Voire même, ô comble de l’horreur, se retrouver transformé en homosexuel…
Le psychisme humain est ainsi fait qu’il voit dans ses ombres des monstres persécuteurs. Attaquer ce qui nous hante est alors une stratégie de conjuration dont les tristes exemples historiques abondent. Là encore, imputer la responsabilité aux seuls homme serait passer à côté de l’essentiel : si les femmes connaissaient mieux leur corps, elles ne se laisseraient plus duper en cherchant hors d’elle le membre érectile représentant leur capacité à rester debout et/ou à irradier leur force créatrice. Car l’escroquerie majeure du système patriarcal, c’est de nous convaincre que le phallique est hors de nous, que l’internalisation de notre puissance n’est pas la meilleure défense contre l’angoisse de castration, et que nous aurions besoin d’instrumentaliser un tiers pour relever les défis de la vie.
Au final, la question n’est donc pas tant de déterminer quel serait vraiment le sexe le plus fort, ou encore de discuter les rôles sociaux découlant de cette hiérarchie, mais bien d’admettre que l’angoisse de castration soit peut-être plus une affaire d’hommes que de femmes. Une sorte de complexe phallique – pendant de l’hystérie ? – dont la restitution pourrait être l’avènement d’une nouvelle posture féministe.
(1) film de Bryan Singer